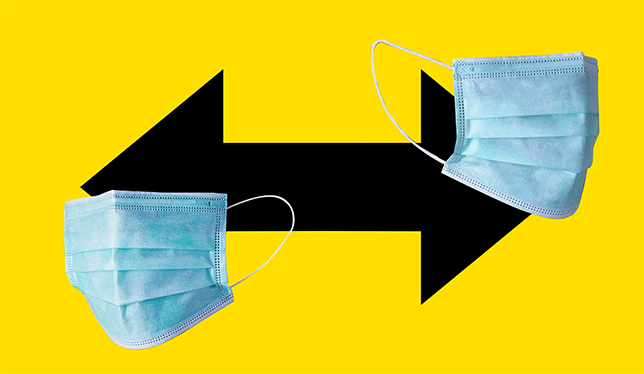Restez chez vous. Contribuez à aplatir la courbe. Respectez la distance de deux mètres. Restez dans votre « bulle sociale ». Portez un masque.
Pour réduire la propagation de la COVID-19, les autorités de santé publique nous ont demandé de modifier nos comportements en un éclair. Pendant que les Canadiens tentaient de se plier à leur dernière recommandation, des chercheurs et chargés de cours universitaires ont pris des notes. Des universitaires issus de disciplines allant de la santé publique à l’anglais en passant par la philosophie étudient actuellement les messages transmis : ce qui est dit, comment ça l’est et surtout ce qui trouve écho. Malgré une communication très efficace à maints égards, pour certains les messages de santé publique se sont révélés contradictoires, déroutants, voire injustes.
« Face à la COVID-19, il n’existe ni remède, ni immunité naturelle, ni vaccin. La communication est notre seule arme, on ne peut compter que sur le respect des recommandations formulées », résume Josh Greenberg, directeur de l’École de journalisme de l’Université Carleton. Les leçons tirées des messages en matière de santé publique transmis pendant la pandémie auront des répercussions sur la lutte contre d’autres menaces, telles que la réticence à la vaccination ou les changements climatiques, qui doit, elle aussi, passer par la collaboration et d’importants changements de comportement.
Revenons en arrière. Début mars, les Canadiens se préparaient à profiter de la semaine de relâche. Le 9, M. Greenberg s’est envolé pour la République dominicaine avec sa famille. Il raconte : « Au Canada, les autorités de santé publique recommandaient simplement d’éviter de se rendre dans les pays considérés des foyers. » Ceux-ci se limitaient à l’époque aux pays du Sud-Est asiatique, à l’Iran et à l’Italie. Mais quatre jours plus tard, le message du gouvernement fédéral a brusquement changé : « Si vous êtes à l’étranger, rentrez au Canada dès que possible. »
Les Canadiens se sont montrés réceptifs. En période de grande incertitude, la plupart d’entre nous ne demandent qu’à se fier aux recommandations des dirigeants gouvernementaux et des experts en santé publique. Maya Goldenberg, professeure agrégée à l’Université de Guelph, spécialisée en philosophie de la médecine et de la science, rappelle que selon le baromètre de confiance Edelman, le pourcentage de Canadiens faisant confiance au gouvernement est passé de 50 à 70 pour cent entre janvier et la mi-avril. Pendant que partout dans le monde les pays se confinaient l’un après l’autre, la théorie dominante selon laquelle « il n’y a plus d’expertise qui tienne » s’est révélée fausse.
« Face à une menace nouvelle, le message doit être parfaitement clair, sans quoi les gens commencent à forger leurs propres réponses aux questions en suspens. »
« Les gens étaient en quête d’une expertise plus conventionnelle », affirme Mme Goldenberg, soulignant que les Canadiens et les Américains considéraient alors les chercheurs, les médecins et les responsables nationaux de la santé comme les sources d’information les plus fiables sur la pandémie. « Des noms comme celui d’Anthony Fauci [le directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses] leur sont devenus familiers. »
Les responsables fédéraux, provinciaux et locaux de la santé publique nous ont dit de rester chez nous – sauf les travailleurs essentiels –, et la plupart d’entre nous avons obtempéré. Ils nous ont dit de respecter l’éloignement physique recommandé et, en quelques jours, nous nous sommes mis à nous éviter sur les trottoirs, à rester sagement debout sur les marques au sol distantes de deux mètres dans les magasins. Ils nous ont dit qu’il fallait « aplatir la courbe » pour que nos hôpitaux ne soient pas saturés, et nous y sommes parvenus.
Rob Steiner, directeur du programme Dalla Lana pour le journalisme mondial de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto, considère que parler d’aplatissement de la courbe est un exemple remarquable de communication en matière de santé publique. Simple et mémorisable, cette formule n’en véhicule pas moins des idées complexes sur les courbes liées aux maladies infectieuses et sur les capacités du système de santé, tout en fixant un objectif collectif mesurable.
Des messages contradictoires
Mais des problèmes ont vite surgi. Dès leur retour à Ottawa, le 16 mars, M. Greenberg et sa famille se sont heurtés à des messages contradictoires, le gouvernement ontarien invitant simplement les voyageurs qui ne rentraient pas de pays considérés des foyers à surveiller l’apparition de symptômes, tandis que le gouvernement fédéral demandait à tous ceux qui rentraient au pays de s’isoler pendant deux semaines. Impossible, en outre, de trouver des réponses claires à des questions élémentaires concernant par exemple s’il était permis d’aller faire un tour à pied ou en voiture. « Face à une menace nouvelle, le message doit être parfaitement clair, sans quoi les gens commencent à forger leurs propres réponses aux questions en suspens », affirme-t-il.
En plus de déplorer l’absence de messages clairs, Colleen Derkatch, professeure agrégée d’anglais à l’Université Ryerson, qui étudie la rhétorique de la santé et de la médecine, souligne que l’information émanant des autorités de santé publique semblait à la traîne par rapport au savoir scientifique. « Il y avait un réel décalage entre ce qu’on lisait dans les médias et les propos sur le virus tenus par les responsables ontariens de la santé publique. » Même après qu’un homme de Sudbury eut été infecté pendant qu’il assistait à une importante conférence du secteur minier à Toronto, la médecin-hygiéniste en chef adjointe de la métropole, Barbara Yaffe, a soutenu que cela ne constituait pas une preuve de transmission communautaire, laissant entendre que le virus ne touchait encore que les voyageurs et les personnes en contact immédiat avec les cas connus.
Selon Mme Derkatch, un message faisant preuve d’un peu d’humilité aurait été un vrai plus. Les responsables de la santé publique auraient dû admettre qu’on ignorait encore bien des choses sur les lieux et les modes de propagation du coronavirus, par manque de capacités en matière de tests et de traçage. (Mme Derkatch est presque certaine que les membres de sa famille ont tous contracté la COVID-19 en mars, mais n’ont pu être testés parce qu’ils ne répondaient pas aux critères d’alors.) Plutôt que de parler de « cas », les responsables auraient dû parler de « cas connus », estime Mme Derkatch. « Cette minuscule distinction fait une énorme différence. »
Fin mars, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a affirmé pratiquement sans broncher que « le port du masque par les personnes asymptomatiques ne servait à rien ». Même si les responsables de la santé publique modifieront sans doute leur discours en fonction des nouvelles données disponibles, Mme Goldenberg estime qu’ils devraient préciser sans attendre que leurs décisions reposent sur des données peu fiables et que leurs recommandations pourront changer du tout au tout avec l’évolution des connaissances.
« Les responsables gouvernementaux ont peur d’admettre ce qu’ils ne savent pas », dit-elle, alors que les études montrent que cela n’est pas de nature à éroder la confiance du public. Celui-ci risque toutefois de perdre confiance en eux s’il estime qu’ils exagèrent quand ils parlent de risques et de sécurité, précise Mme Goldenberg dont l’ouvrage Vaccine Hesitancy: Public Trust, Expertise, and the War on Science paraîtra au printemps 2021. Une étude a ainsi montré que la confiance du public envers les responsables de la santé publique du Royaume-Uni a chuté dès l’instant où ils ont affirmé que les vaccins étaient absolument sans danger.
Spécialiste de l’étude des facteurs humains, Holly Witteman, professeure agrégée au Département de médecine familiale et d’urgence de l’Université Laval, reconnaît que « les communicants en santé publique sont loin d’avoir la tâche facile ». Elle ajoute qu’il existe peu d’études sur ce qui permet ou non d’amener les gens à modifier leur comportement pendant une pandémie. C’est justement pour le déterminer que, grâce à une subvention du gouvernement canadien annoncée en juin, Mme Witteman étudie la perception de l’efficacité des messages de lutte contre la COVID-19 par les Canadiens afin d’identifier lesquels ont eu l’effet escompté. Dans la même veine, une équipe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke mène pour sa part une analyse comparative internationale de l’influence des stratégies de communication et des médias sur la réaction psychologique et comportementale des populations à la COVID-19.
L’un des messages dont Mme Witteman entend évaluer l’efficacité est celui qui a trait à la règle des deux mètres. Selon elle, bien des gens l’interprètent à la lettre, croyant que le fait de se trouver même brièvement à moins de deux mètres de quelqu’un est très risqué, mais qu’il n’y a aucun risque dès que cette distance est respectée. Alors que le risque est bien sûr « graduel », la règle des deux mètres ne visant qu’à le réduire, et non à l’éradiquer, explique Mme Witteman. Cette règle pousse de plus à minimiser l’importance d’autres facteurs.

Un modèle de communication bidirectionnel
La levée progressive des restrictions par les provinces n’a fait que complexifier le message. Selon M. Steiner, après avoir abreuvé les gens de consignes simples du genre « restez chez vous », on leur a dit qu’il fallait trouver un équilibre, reprendre le travail, recommencer à vivre – et désormais envoyer leurs enfants à l’école – malgré les risques de contamination.
Convaincu qu’il faut passer d’un modèle de communication unidirectionnel à un modèle bidirectionnel, il cite comme exemple de piètre communication unidirectionnelle le « désastre » de Trinity-Bellwoods, lors duquel des résidents de Toronto s’étaient rassemblés dans un parc sans éloignement physique dès le retour des beaux jours, au printemps dernier. Le maire torontois, John Tory, avait qualifié leur comportement d’« incroyablement décevant », tandis que la médecin-hygiéniste en chef de la ville, Eileen de Villa, avait taxé les participants à ce rassemblement d’« égoïstes ». Enjoints de ne pas se rassembler, les résidents ont réagi, rappelle M. Steiner : « On a absolument besoin de reprendre une vie sociale, de prendre l’air. C’est essentiel. » S’ils avaient été conscients de cela, les responsables de la santé publique auraient pu peaufiner leur communication, encourager le respect de l’éloignement physique à l’extérieur tout en limitant l’ampleur des rassemblements.
« C’est ce qu’ils réussissent mieux en Colombie-Britannique, mieux qu’en Ontario. Ils écoutent la population et adaptent leur communication à ce qu’elle dit », commente M. Steiner, ajoutant que dès que la responsable de la santé publique de cette province de l’Ouest, Bonnie Henry, a su que le confinement rendait les gens anxieux, elle les a encouragés à sortir de chez eux pour préserver leur santé mentale et physique.
Il n’est évidemment pas facile d’établir une communication bidirectionnelle avec un éventail de Canadiens dont la tolérance au risque, les comportements et la littératie scientifique sont très variables. M. Greenberg précise que les études qu’il mène avec ses collègues montrent que « les gens ont vécu très différemment la pandémie en fonction de leur âge, de leur statut socioéconomique, de leur exposition à la mésinformation et de leur allégeance politique ». D’après lui, plus les provinces déconfinent et autorisent divers comportements, plus les messages de santé publique doivent être ciblés. Ils ne doivent en outre pas être uniquement véhiculés par les responsables de la santé publique, mais aussi entre autres, par les dirigeants religieux, les organisations communautaires et les médias locaux.
Selon Fatima Tokhmafshan, généticienne et bioéthicienne au Centre universitaire de santé McGill, le message adressé doit en particulier viser les populations racisées dans de nombreux quartiers très touchés. Elle souligne qu’à Montréal, les habitants d’Hochelaga, de Côte-des-Neiges et de Montréal-Nord « n’ont reçu aucun dépliant rédigé dans les langues des populations majoritaires au sein de ces arrondissements ». Parallèlement, « la discrimination systémique et les préjugés érodent fortement la confiance des minorités dans les institutions publiques », selon celle-ci, qui se rappelle avoir entendu un membre du personnel de santé s’interroger sur l’intelligence d’une réfugiée syrienne incapable de communiquer en français ou en anglais.
Ce manque de confiance conduit les minorités à rechercher de l’information dans leur langue au sein de leur communauté, et sur les plateformes comme Facebook ou WhatsApp où la mésinformation sur la pandémie abonde. Selon Mme Tokhmafshan, les études montrent que l’« affirmation identitaire » est la clé en pareil cas. D’après elle, le fait qu’un professionnel de la santé musulman discute de mesures d’éloignement physique avec sa communauté peut grandement contribuer à enrayer la « dissonance cognitive » qui se produit quand une nouvelle information contredit celle qui émane de sources jusqu’alors jugées fiables. Mais pour cela, précise Mme Tokhmafshan, il faut que les responsables de la santé publique entretiennent des relations stables avec les dirigeants et les aînés de la communauté, ce qui est rarement le cas.
En résumé, selon Mme Derkatch, les responsables de la santé publique doivent établir avec chaque communauté la relation bidirectionnelle évoquée par M. Steiner, recueillir des données sur ce qui motive les comportements plutôt que simplement communiquer de l’information. D’après elle, les communicants en santé publique doivent « aller à la rencontre des gens plutôt que de les montrer du doigt ». Un bon début serait de « simplement admettre à quel point les choses sont difficiles pour tout le monde ».