Après avoir couché par écrit le récit de ses cinq années comme recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) dans le livre Un rectorat sous tension : projets, occasions et adversités, Denis Harrisson a accepté de répondre à quelques questions sur son expérience. Dans la préface qu’il signe, l’ancien recteur de l’Université du Québec à Montréal, Claude Corbo, soutient qu’avec ce livre, M. Harrisson « rend service à tout le milieu universitaire québécois qu’il invite à réfléchir à de multiples enjeux relatifs à la dynamique interne de la vie universitaire, aux conditions de développement et de la diffusion du savoir, à la gouvernance de l’institution universitaire, à ses rapports avec la société environnante et avec le pouvoir gouvernemental ». Voici un aperçu de la réflexion qui l’a amené à s’engager sur cette voie.
Affaires universitaires : Peu de dirigeant.e.s choisissent de prendre la plume pour raconter ce qui se passe derrière les portes closes de l’administration universitaire, encore moins quand l’expérience n’a pas été de tout repos, qu’est-ce qui vous a poussé à franchir le pas?
Denis Harrisson : J’avais lu le livre de Robert Lacroix, qui est un ancien recteur de l’Université de Montréal. C’est un peu ce qu’il fait. J’ai également lu le livre de Clark Kerr, qui était président de l’Université de Californie à Berkeley, qui en a écrit plusieurs sur la direction des universités et qui y allait de façon assez honnête et sincère. J’ai vécu la période post-2012. Il y avait quand même beaucoup d’action à l’université.
À lire aussi : L’énigmatique héritage du Printemps érable
J’avais envie d’être sincère et authentique. Je livre ma réflexion sans tabou, sans amertume, telle quelle. Les relations de travail sont difficiles dans plusieurs universités, puis on n’en parle jamais.
J’ai été professeur pendant longtemps et comme professeur.e, on ne sait pas comment ça fonctionne, l’université. On s’imagine des choses, mais on ne le sait pas. De un, l’objectif du livre est de dire « voilà comment ça fonctionne », de mon point de vue. Deuxièmement, [d’expliquer] comment cette période post-2012 s’est passée de l’intérieur. Je trouvais que je pouvais livrer un témoignage. Je pense que si des candidat.e.s au rectorat se disent : « Je vais finir ma carrière. Ça va être tranquille, ça va être le fun… », c’est qu’ils et elles ne savent pas. Les petits jeux de coulisse, le pouvoir, les relations avec le gouvernement, les relations avec la communauté, les relations à l’interne : c’est un jeu d’équilibriste. Quand on reçoit une revendication, c’est toujours comme si la personne qui demande, elle est seule. Quand tu regardes de près, si tu fais ce qu’elle demande, ça crée une conséquence sur une autre. C’est un jeu de dominos. [Je voulais] essayer d’expliquer ça.
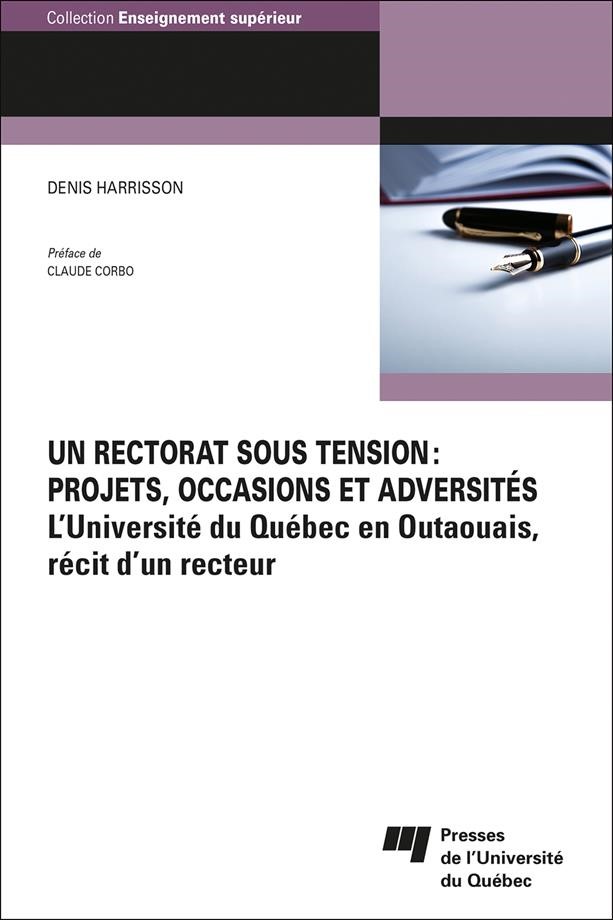
AU : Est-ce que vous avez écrit le livre que vous auriez aimé lire avant de vous lancer pour devenir recteur?
M. Harrisson: Certainement que j’aurais aimé ça, lire un livre sur des expériences au rectorat. On se lance là-dedans sans expérience. J’ai été vice-recteur, j’avais déjà été dirigeant d’un centre de recherche, puis directeur du département, mais ça ne te prépare pas suffisamment. Au rectorat, tu es vraiment tout.e seul.e. C’est rare qu’on vienne te voir en disant « On a un problème? » et « J’ai la solution ». Quand on vient te voir avec un problème, c’est parce qu’il ne s’est pas réglé avant. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’on soit toujours remercié.e pour nos bons services. Il faut être humble, accepter d’avoir le dos assez large pour prendre les critiques, même quand tu n’es pas responsable.
AU : Vous n’y allez pas par quatre chemins pour exposer certaines tensions entre l’administration et les syndicats à l’UQO, pourquoi c’était important pour vous d’évoquer ces questions qui ne sont généralement pas abordées de façon aussi ouverte?
M. Harrisson : La vérité, c’est que c’est quand même assez délicat. À l’époque, à l’UQO, c’était l’endroit le plus difficile quoique j’allais aux rencontres d’Universités Canada, puis je m’apercevais que dans d’autres provinces, ça rockait aussi. Je viens du milieu syndical. Je n’aurais pas pensé que ça allait être aussi difficile : pas de possibilités de s’entendre, pas de compromis. Les revendications classiques de conditions de travail, salaire, tout ça, ça n’a jamais été un enjeu, ç’a toujours été la gouvernance. C’est ça qui est spécial, c’est que le syndicat revendique une place dans la gouvernance de l’Université.
AU : Vous brossez un portrait relativement sombre de l’exercice de la collégialité, l’UQO est-elle l’exemption ou la règle à cet égard?
M. Harrisson : En fait, la cogestion, ça fonctionne si tu es de bonne foi, si tu sais pourquoi tu es là. Mais moi, ce que j’ai trouvé particulièrement difficile, c’est quand le syndicat s’en mêlait, c’est-à-dire qu’il disait : « La cogestion, ce n’est pas les professeur.e.s, c’est nous. » Si vous voulez faire de la cogestion, il faut passer par nous. On va vous dire qui va siéger sur tel comité ou telle instance et puis nous allons leur donner des directives. Là, on n’est plus dans la cogestion.
Je pense qu’il y a matière à réflexion sur la question des instances. À l’Université du Québec, il va peut-être y avoir une réflexion, mais [pour qu’il y ait] des changements, il faudrait que ça passe par la loi. Puis ça, la loi, personne ne veut toucher à ça avec une perche de quinze pieds.
« Moi, je peux dire, après avoir écrit ça, que je serais un bien meilleur recteur maintenant que je l’ai été à l’époque, ça c’est sûr. »
AU : Est-ce qu’écrire sur votre expérience permet, jusqu’à un certain niveau, de prendre un peu de recul par rapport à ce qui s’est passé et d’avoir un regard neuf sur les choses?
M. Harrisson : C’est sûr que l’écriture, ça permet aussi de faire un certain bilan. Puis de l’écrire, ça permet aussi d’approfondir les réflexions sur ce qui s’est passé. Moi, je peux dire, après avoir écrit ça, que je serais un bien meilleur recteur maintenant que je l’ai été à l’époque, ça c’est sûr. Mais bon, j’ai passé mon temps.
AU : Maintenant que vous avez partagé votre expérience dans le livre, qu’est-ce qui vous retenez de ces années comme recteur?
M. Harrisson : Je ne pars pas avec des regrets en me disant : « Je n’aurais jamais dû aller là. » Je suis très content de l’avoir fait. J’ai appris beaucoup de choses, puis je pense que [les conflits] se sont éteints environ un an avant que je quitte, c’était beaucoup plus civil. Parallèlement à ça aussi, on travaillait sur des projets. C’est ça qui était magnifique. On avait eu un statut particulier en Outaouais, c’était pour développer l’université. Dans le fond, c’était ça aussi qui m’intéressait bien plus que ces affaires-là à l’interne. Les petites batailles, disons que ça colore un peu ton quotidien, mais le mandat, c’était développer l’UQO et d’aller chercher du financement du gouvernement du Québec pour développer de nouveaux programmes.
AU : En 2022, un rapport de l’Observatoire de développement de l’Outaouais estimait à 60 le nombre de programmes manquants à l’UQO. Avec un si grand décalage, est-il même réaliste de penser qu’un jour l’UQO aura réussi à rattraper le retard ou est-ce plutôt une course éternelle?
M. Harrisson : On n’aura jamais les 60 programmes qu’il faut construire. D’abord, si on avait 60 programmes d’un coup, il faudrait avoir des ressources pour absorber tout ça. Je pense qu’il faut s’asseoir avec le gouvernement, puis développer un plan de développement à long terme sur 10, 15, peut-être même 20 ans. Quand on a eu du financement pour développer de nouveaux programmes, on pouvait le faire à raison d’un programme de grade par année. Un rythme d’un par année, je pense qu’on ne tient même pas ça.
C’est plein de conséquences. Ce n’est pas si simple que ça de dire « On ouvre un programme, on les installe dans une classe, puis on y va ». Et c’est pour ça que ça prend l’assistance du gouvernement qui pourrait nous financer pour la mise en œuvre.
AU : Les contraintes financières de l’UQO occupent une partie importante dans votre livre, la ministre de l’Enseignement supérieur du Québec a lancé il y a quelques mois le processus de révision de la Politique québécoise de financement des universités, croyez-vous que l’UQO arrivera à obtenir sa juste part dans cet exercice?
M. Harrisson : La formule de financement qui a été décidée en 2018, c’était pour cinq ans. En 2018, on a créé un certain équilibre, puis à chaque fois qu’on crée un équilibre des budgets, ça tend vers le déséquilibre.
On est différent d’une université à l’autre. On a nos besoins spécifiques que d’autres n’ont pas. Est-ce que c’est ça qui s’est produit durant les cinq années de la hausse du financement des universités au Québec? En plus, il y a eu la question des étudiant.e.s provenant de l’international. On nous disait : « Vous pouvez recruter les étudiant.e.s à l’étranger, puis garder les droits de scolarité pour vous. Vous ne les retournez pas à Québec comme avant. » C’était supposé être la manne. Mais, les étudiant.e.s francophones n’obtiennent pas de visa. Ça ne va pas bien là.
À lire aussi : Permis d’études : le haut taux de refus cause des maux de tête
AU : Vous abordez l’autonomie institutionnelle et le rôle du recteur ou de la rectrice qui varie entre développeur autonome et fonctionnaire qui répond à un.e ministre, est-ce un virage qui vous inquiète? Pourquoi?
M. Harrisson : Je dirais que ça dépend des gouvernements. Il y a des gouvernements qui aiment travailler avec les universités, qui ont une vision sur les universités et veulent la partager avec les dirigeant.e.s universitaires. Il y a d’autres gouvernements qui ont une vision de l’université et qui veulent l’imposer. Il ne faut pas que le gouvernement impose des affaires. Moi, j’ai connu la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur. On était aux prises avec différents types de problèmes de cet ordre-là. La ministre est arrivée avec un projet de loi. Elle ne l’a pas fait toute seule dans son coin, elle l’a quand même travaillé avec les universités. Tant que le gouvernement travaille avec les universités comme des partenaires autonomes, je n’ai aucun problème avec ça. À partir du moment où on nous prend pour des employé.e.s de l’État en disant : « C’est le ou la ministre qui décide, toi, tu exécutes », là, on s’en prend à l’autonomie des universités. Puis là, je vois ça comme une dérive de la mission fondamentale de l’université parce qu’on sait quand même comment s’y prendre pour résoudre un certain nombre de problèmes.
« Je pense qu’il faut arriver avec une réflexion, un plan bien défini sur ce qu’on veut faire, puis s’y tenir. Si cette personne est nommée, c’est que ce qui a été annoncé est accepté par la communauté universitaire. »
AU : Que répondriez-vous à quelqu’un qui n’est plus certain.e de vouloir tenter sa chance dans la course au rectorat après avoir lu votre livre?
M. Harrisson : Je souhaite que les candidat.e.s qui veulent se lancer dans une aventure d’administration universitaire puissent lire le livre. Ça ne veut pas dire de ne pas y aller. Quand on se lance dans un poste comme ça, on dit : « On va développer des projets pour ça, ça et ça », mais c’est le quotidien qui te rattrape. Je pense que le livre peut rendre service [aux cadres supérieurs et, en particulier, aux vice-recteurs et vice-rectrices à l’enseignement et à la recherche]. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça dans leur université, mais il faut qu’on s’attende à ce qu’il y ait des épisodes moins drôles, où les dirigeant.e.s vont être sur la sellette et seront tenu.e.s responsables.
AU : Si vous aviez à donner un conseil à quelqu’un qui considère se lancer dans le rectorat, qu’est-ce que ce serait?
M. Harrisson : Je pense qu’il faut arriver avec une réflexion, un plan bien défini sur ce qu’on veut faire, puis s’y tenir. Si cette personne est nommée, c’est que ce qui a été annoncé est accepté par la communauté universitaire. Durant son mandat, il faut développer le plan, malgré tout ce bruit autour et ne pas lâcher. Parce qu’on réussit à faire de très belles choses pareilles. Moi, le quotidien m’a surpris. Je n’aurais jamais pensé que ça allait prendre autant de mon temps. Mais en même temps, les autres projets, le campus unifié, les développements de programmes, asseoir la recherche de l’université, on réussit à le faire quand même. Au bout du compte, ce n’est pas négatif.
AU : Si on ne devait retenir qu’une seule chose de votre livre, qu’aimeriez-vous que ce soit?
M. Harrisson : Que l’université progresse et réussisse quand même à être ce qu’elle est, c’est-à-dire un lieu d’accueil pour les étudiant.e.s, puis un lieu de discussion, mais que ce n’est pas toujours facile. Ne pensez pas que l’université, c’est un grand long fleuve tranquille. Ce n’est pas ça.
AU : Si vous aviez le pouvoir d’encourager un.e de vos homologues à rédiger un livre sur son rectorat, vers qui vous tourneriez-vous?
M. Harrisson : Je ne vais pas vous citer quelqu’un, mais j’aimerais bien qu’un.e collègue d’une université à charte rédige quelque chose parce que de notre vue d’une université du Québec, une université à charte, c’est comme si ça marchait parfaitement.
Cet entretien a été revu et condensé pour plus de clarté.
