Au moment de l’avènement des universités occidentales, il n’y avait aucune équivoque quant à l’identité de la discipline qui était la « reine des sciences ». Le lent déclin de la théologie s’est ensuite amorcé – non seulement dans la vie intellectuelle, mais aussi en tant que tremplin essentiel vers une carrière prospère. On peut sans peine s’imaginer les théologiens se réunir pour discuter des raisons, des pertes subies, des boucs émissaires et des moyens pour contrer la situation. Après plus de 10 ans de désintérêt grandissant, comme en font foi les inscriptions dans les programmes de sciences humaines, ces conversations ont aujourd’hui lieu dans les facultés d’arts libéraux du monde anglophone. Considérations divines ou humaines, même combat. Alors que se conclut le 25e anniversaire de la parution de Who Killed Canadian History?, l’ouvrage de Jack Granatstein qui a mis le feu aux poudres de la guerre des historien.ne.s et des guerres culturelles au pays, aucun sujet n’est plus clivant, dans le milieu universitaire et ailleurs, que l’histoire, plus précisément l’histoire canadienne.
Les faits sont clairs, même si leur signification ne l’est pas. Alex Usher l’a illustré à plusieurs occasions dans son blogue sur le site de Higher Education Strategy Associates (HESA) : les inscriptions aux programmes de sciences humaines dans les universités canadiennes ont atteint un sommet en 2010-2011, avant de dégringoler année après année. Depuis 2016, les chiffres sont statiques. Les domaines les plus touchés sont ceux que M. Usher qualifie de sciences humaines « narratives », à savoir la littérature (française ou anglaise) et l’histoire. Pour les deux autres grands domaines, la langue et la linguistique ainsi que la philosophie, la baisse est moins brutale. Le nombre d’inscriptions dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM), en santé et en gestion, qui augmente sans cesse depuis le début du siècle, a explosé tandis que celui en histoire est passé de plus de 15 000 à environ 10 000, une chute de 35 %.
Il y a moins de données pour les cycles supérieurs dans ce domaine, mais la situation semble tout aussi sérieuse. L’Université de Victoria a admis 23 étudiant.e.s aux cycles supérieurs en histoire en 2010. Cette année, elle n’en a admis que 10, raconte Penny Bryden, professeure d’histoire. Et ce n’est pas seulement parce que le nombre d’inscriptions a baissé, passant de 77 en 2010 à 52 l’an dernier. Il y a également moins de professeur.e.s dans bon nombre de départements d’histoire, car les départs n’ont pas été remplacés faute d’un effectif étudiant suffisant. Par exemple, le Département d’histoire, d’études classiques et de religion de l’Université de l’Alberta a vu le nombre de postes professoraux chuter de 40 % au cours des 15 dernières années, selon son directeur, Ryan Dunch. C’est sans compter la baisse du financement, se désole Mme Bryden. Dix étudiant.e.s aux cycles supérieurs, c’est « tout ce que nous pouvions nous permettre ».
« Il n’y aura plus de doctorant.e.s qui se spécialiseront en histoire économique, politique et militaire canadienne. […] C’est une immense menace à l’identité et à l’unité nationales. »
Professeur d’histoire à l’Université Dalhousie et membre du groupe de travail sur l’avenir du doctorat en histoire au Canada de la Société historique du Canada (SHC), Will Langford a écrit dans un texte pour le site Web Active History qu’entre 2016 et 2020, on publiait en moyenne 100 dissertations doctorales chaque année, un nombre qui a chuté au cours des deux années suivantes. Il est probable, selon lui, que ce déclin soit en grande partie attribuable aux mesures de restrictions pandémiques, empêchant les doctorant.e.s de se déplacer et d’accéder aux archives. Toutefois, les recherches portant sur la baisse des inscriptions au doctorat menées par Catherine Carstairs, membre du même groupe de travail et professeure à l’Université de Guelph, indiquent que le nombre de thèses ne reviendra pas à son niveau d’antan. Pour Mark Bourrie, avocat, historien et auteur de Bush Runner, biographie primée de Pierre-Esprit Radisson, il y a moins d’étudiant.e.s au doctorat car « les universités ont cessé il y a plusieurs années d’ouvrir des postes menant à la permanence, surtout pour des canadianistes. De nos jours, les titulaires d’un doctorat en sciences humaines peuvent au mieux espérer être chargé.e de cours ».
Si telle est la raison pour laquelle de moins en moins de d’étudiant.e.s aux cycles supérieurs choisissent d’emprunter le chemin toujours plus restreint vers l’enseignement de l’histoire, la racine du problème est plus profonde : il y a tout simplement moins d’étudiant.e.s de premier cycle dans ce domaine. Les parties concernées s’entendent généralement pour dire que cette baisse repose sur des tendances similaires – pédagogiques, économiques, sociales et démographiques. C’est par la suite que ça se gâte.
Pour certaines personnes, la plupart des intellectuel.le.s n’ayant aucun lien avec les départements d’histoire, la situation est très problématique et tire notamment son origine du fait qu’on enseigne trop peu l’histoire au primaire et au secondaire, et qu’on l’enseigne mal. Dans son livre The Vanishing Past, un plaidoyer fascinant et informatif pour davantage de contenu narratif et factuel dans l’enseignement de l’histoire de la maternelle à la 12e année, publié en 2020, Trilby Kent indique qu’en Ontario, « l’histoire représentait 11,4 % des cours en 1964, alors qu’elle n’en représentait que 6,6 % en 1982 ». Selon elle, l’histoire sociale, en popularité grandissante depuis les années 1970, n’a pas seulement mis les formes plus traditionnelles de l’histoire (politique et économique), sur la voie de service : elle tend également vers la fragmentation et le sectarisme, des forces antinomiques au type de récit qui rend la discipline attirante aux yeux des enfants.
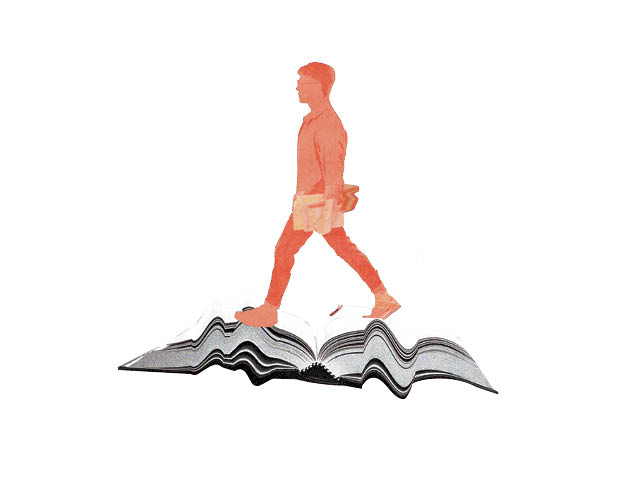
Professeur adjoint en sciences de l’éducation à l’Université Saint Mary’s, Paul W. Bennett souligne que l’histoire est l’art libéral dont les exigences de lecture sont les plus ardues, ce qui constitue un frein pour des étudiant.e.s qui vivent dans une société toujours plus axée sur le visuel. « Je crois que les cours d’histoire sont devenus moins populaires car ils sont beaucoup plus exigeants. » À la fin de l’année dernière, le site d’information The Hub a publié une série d’articles dans le cadre du 25e anniversaire du livre de M. Granatstein. On y décriait notamment une obsession par les historien.ne.s pour les identités régionale, de classe, de genre et ethnique qui fait voler en éclats le peu de sentiment national collectif qui subsiste chez les Canadien.ne.s. On y postule également que M. Granatstein était trop optimiste lorsqu’il craignait la disparition potentielle d’un récit unifié.
« Je ne peux pas m’imaginer comment on expliquera le Canada dans 15 ou 20 ans, se désole M. Bennett. Les versions qu’on nous présente aujourd’hui seront incompréhensibles et impossibles à communiquer à un vaste public. » Selon Christopher Dummitt, professeur d’études canadiennes à l’Université Trent, l’histoire du Canada sera bientôt moins inexplicable qu’extrêmement négative – on présentera le récit d’un pays illégitime et « colonisateur, au passé imprégné de racisme ». Il ajoute que cette nouvelle trame nationale effacera complètement « le fait qu’à travers toute cette diversité opprimée, il y avait un véritable récit canadien ».
« Nous avons du mal à nous imaginer comment notre formation pourrait mener à un emploi et avons oublié l’idée qu’un diplôme universitaire ne nous prépare pas seulement à travailler, mais aussi à devenir membre d’une communauté et à participer au commun. »
De toute façon, affirme M. Bourrie, d’ici une génération ou deux, « il n’y aura plus de doctorant.e.s qui se spécialiseront en histoire économique, politique et militaire canadiennes. Il n’y a déjà presque plus personne qui travaille sur l’histoire des provinces. C’est une immense menace à l’identité et à l’unité nationales ».
Or, pour certain.e.s universitaires, cette perspective est au mieux exagérée, au pire carrément erronée. Carla Peck, professeure en enseignement des études sociales à l’Université de l’Alberta, en est à la cinquième année de l’étude septennale Penser historiquement pour l’avenir du Canada, la première depuis 1968 à porter sur l’enseignement de l’histoire au Canada de la maternelle à la 12e année. « Il s’agit du plus important programme financé par le Conseil de recherches en sciences humaines hormis les chaires de recherche du Canada, explique Mme Peck. Mon équipe de 30 chercheurs et chercheuses compte des historien.ne.s et des personnes qui travaillent dans des facultés d’éducation. » L’étude vise à « comprendre comment la pensée critique au service de l’apprentissage et de l’enseignement de l’histoire – et j’entends critique au sens d’analyser, pas de réprouver – peut contribuer à développer des citoyen.ne.s doté.e.s d’un bon esprit critique. L’enseignement de l’histoire s’est toujours justifié par l’idée de former de meilleur.e.s citoyen.ne.s, et le contenu est tout aussi essentiel que d’apprendre comment les connaissances historiques sont produites. On ne peut enseigner des notions de réflexion historique sans contenu historique. »
Mme Bryden, ancienne présidente de la SHC dont les recherches portent sur l’histoire politique et constitutionnelle moderne du Canada, fait écho aux propos de M. Bourrie, faisant remarquer que son département n’offre actuellement aucun cours sur l’histoire de la Colombie-Britannique. Par contre, elle dit enseigner à beaucoup d’étudiant.e.s plusieurs cours d’histoire politique, diplomatique et militaire, dont la supposée disparition fait tant couler d’encre.
Celle-ci est également d’avis que le changement de terminologie explique en partie le déclin apparent de l’enseignement de l’histoire. De la maternelle à la 12e année, l’histoire fait partie des sciences sociales et, même à l’université, « on la déguise sous d’autres noms, affirme-t-elle. Je crois que l’histoire de notre pays se cache dans des cours qui ne sont pas intitulés Le Canada depuis 1867, mais qui portent sur des sujets – l’environnement ou les changements climatiques, par exemple – qui sont presque exclusivement canadiens, du fait de notre emplacement. Je ne crois donc pas que le déclin soit aussi prononcé ou spectaculaire qu’on le dit. »
Dans un autre texte publié en janvier sur Active History, Thomas Peace affirme que personne n’a tué l’histoire canadienne. En fait, ce qui doit mourir, c’est la guerre des historien.ne.s. L’homme au nom prédestiné, professeur agrégé d’histoire au Collège universitaire Huron, ne crie pas victoire pour son camp. Dans ce conflit acerbe, il tend plutôt un rameau d’olivier à quiconque n’a pas la même opinion, car les historien.ne.s, selon lui, doivent s’unir face à un ennemi commun, soit « la prédominance des programmes préparatoires à l’emploi [contrairement à l’éducation plus formatrice] ».
« Les universités ont cessé il y a plusieurs années d’ouvrir des postes menant à la permanence, surtout pour des canadianistes. De nos jours, les titulaires d’un doctorat en sciences humaines peuvent au mieux espérer être chargé.e de cours. »
Cette tendance sociale prend bien de la place dans l’esprit de celles et ceux pour qui la guerre des historien.ne.s fait beaucoup de bruit pour rien. M. Usher, fils d’un couple d’historien.ne.s, fait remarquer que les inscriptions dans les programmes de sciences humaines ont fondu depuis la sortie de la crise financière de 2008, mais que la chute nous a amenés au niveau de l’an 2000, « alors que le système des sciences humaines fonctionnait très bien ». Est-ce que les historien.ne.s (et les professeur.e.s d’anglais) croient que leurs disciplines sont à l’agonie car elles ont connu un sommet de popularité en 2010?
Si c’est le cas, on peut se demander à quel point leur propre expertise est appliquée à l’histoire de l’enseignement de l’histoire. Si la comparaison avec le sort des théologiens après les guerres de religion européennes est exagérée, il conviendrait de jeter un regard sur l’évolution du curriculum d’histoire. En 1920, soit deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale – l’une des périodes les plus importantes dans l’évolution du Canada moderne – le Département d’histoire de l’Université de l’Alberta offrait huit cours de premier cycle.
Il y avait d’abord le cours d’histoire générale, qui portait sur l’Europe occidentale, de la Renaissance à « aujourd’hui ». Ensuite, deux cours sur l’histoire britannique (pré- et post-1485), trois sur l’histoire européenne, un sur l’histoire constitutionnelle anglaise et enfin, un cours d’histoire du Canada (depuis la Nouvelle-France). Il y a fort à parier que les programmes des universités australiennes et néo-zélandaises étaient pratiquement identiques, pourvu que l’on remplace « Canada » par le Dominion approprié. À moins que ces établissements aient adhéré plus rapidement que l’Université de l’Alberta au nationalisme florissant de l’après-guerre.
Dans le siècle qui s’est écoulé depuis, l’histoire nationale a remplacé l’histoire impériale et s’est fragmentée en plusieurs sous-disciplines – politique, économique, travail, genre, etc. De nos jours, les étudiant.e.s délaissent les enjeux nationaux pour les enjeux locaux (l’identité communautaire ou personnelle) ou internationaux (l’environnement, le colonialisme et le décolonialisme), ou les deux, comme l’explique Mme Bryden à propos de l’histoire des changements climatiques. Depuis quelques années, l’Université de l’Alberta propose des cours sur les drogues dans l’histoire mondiale moderne et sur la peste, les maladies et les épidémies. « Ces cours font salle comble et on parle de 120 étudiant.e.s », raconte M. Dunch. Et il y a d’autres bonnes nouvelles : « Nous sommes passés de 350 étudiant.e.s de premier cycle en 2010 à autour de 200 en 2015. Aujourd’hui, nous en avons environ 255. »

Ces cours d’histoire attirent – autant que peut le faire un cours de sciences humaines – tant les étudiant.e.s de premier cycle né.e.s au Canada que les étudiant.e.s de l’étranger, dont le nombre augmente rapidement formant aujourd’hui près de 20 % des inscriptions dans les établissements postsecondaires du pays. M. Dunch, spécialiste de l’histoire chinoise, compte souvent dans ses cours des étudiant.e.s chinois.es qui étudient en gestion ou dans les STIM. Dimitry Anastakis, titulaire de la chaire L.R. Wilson/R.J. Currie en histoire des affaires canadiennes de l’École de gestion Rotman de l’Université de Toronto et l’un des rares historien.ne.s canadien.ne.s à occuper un poste dans une école de commerce, raconte que la moitié des étudiant.e.s inscrit.e.s à l’École viennent de l’étranger. Ces étudiant.e.s forment également la majorité de son cours optionnel sur l’histoire des affaires canadiennes, offert en deuxième année du MBA, et il y a toujours une liste d’attente, « car ces étudiant.e.s veulent vraiment en savoir plus sur le Canada et son histoire ».
M. Usher est d’accord – l’étudiant.e universitaire d’aujourd’hui n’est pas celui ou celle de 2010, ce qui n’est pas de bon augure pour les sciences humaines. « La proportion d’étudiant.e.s de l’étranger et de Canadien.ne.s de première ou de deuxième génération appartenant à une minorité visible est beaucoup plus élevée, et ces personnes n’étudient pas les mêmes choses que les Canadien.ne.s d’autrefois. » En effet, tant les premiers et premières, qui paient des droits de scolarité quatre fois plus élevés que leurs condisciples canadien.ne.s – une véritable manne qui permet aux universités de survivre malgré la baisse du financement public – que les second.e.s n’ont en tête que les études dans les STIM ou en gestion des affaires.
Voilà une tendance inquiétante et déprimante pour nombre d’universitaires en sciences humaines. « Nous avons du mal à nous imaginer comment notre formation pourrait mener à un emploi, s’attriste Mme Bryden, et avons oublié l’idée qu’un diplôme universitaire ne nous prépare pas seulement à travailler, mais aussi à devenir membre d’une communauté et à participer au commun. Par conséquent, nous avons un peu perdu notre raison d’être. » D’autres ne se laissent pas abattre : « Les emplois hors du milieu universitaire pleuvent pour les personnes diplômées dans des disciplines comme l’histoire, tonne M. Bourrie. Celles qui ont une formation en langue seconde peuvent travailler dans la fonction publique. On peut faire de la recherche, un domaine en pleine expansion, enseigner au secondaire, travailler pour un.e politicien.ne ou faire de la rédaction professionnelle. J’ai été admis en droit – même si j’avais 56 ans – car j’avais eu d’excellentes notes en histoire. »
Les universités ont cessé il y a plusieurs années d’ouvrir des postes menant à la permanence, surtout pour des canadianistes. De nos jours, les titulaires d’un doctorat en sciences humaines peuvent au mieux espérer être chargé.e de cours .
Le problème, selon M. Bourrie, c’est que les départements de sciences humaines mettent moins en vitrine leurs débouchés que les autres départements. Victoire MacNaughton, récemment diplômée en histoire de l’Université de Toronto, ne pourrait être plus d’accord, soulignant le manque de stages, de rencontres régulières avec des ancien.ne.s à la carrière fructueuse et d’autres signes concrets montrant que les départements de sciences humaines sont conscients que leurs étudiant.e.s ont des intérêts intellectuels, mais aussi économiques. M. Usher a développé une théorie générale sur les sciences humaines : elles sont absolument incapables de se vendre. « Leurs liens avec les écoles secondaires sont pratiquement inexistants, tandis qu’on y voit toujours des professeur.e.s des STIM. Demandez aux doyen.ne.s des facultés des arts de vous nommer les cinq principaux employeurs de leurs diplômé.e.s. Généralement, on n’en a aucune idée. La question qu’il faut donc se poser, selon moi, c’est “Pourquoi?”. »
Or, explique M. Usher, « il y a beaucoup de façons extraordinaires de présenter les avenues qu’offrent les arts et les sciences humaines. Il y a sept ou huit ans, alors que les chiffres étaient encore à la baisse, HESA avait mené un projet ayant pour but de vendre les sciences humaines. Nous avions notamment imaginé un camp d’espionnage pour les jeunes de 12 à 14 ans. On y résoudrait des énigmes en lien avec ces disciplines à l’aide d’éléments de langues, de codes ou de documents. Quand on y pense, l’analyse de documents fait partie intégrante des sciences humaines. Les manières de rendre ces disciplines amusantes et attrayantes pour les jeunes ne manquent pas. »
Si tout cela s’applique aux emplois d’historien.ne.s en dehors du milieu universitaire, il importe de noter que le soutien du monde des affaires est assez discret. Le secteur privé et les philanthropes reconnaissent l’importance des connaissances et de la formation historiques, en particulier dans l’optique d’aiguiser la pensée critique. Obtenir un soutien financier pour la chaire fondée en histoire des affaires dont M. Anastakis est titulaire n’a pas été un problème. « Je n’ai jamais amassé trois millions de dollars aussi facilement, raconte Joe Martin, professeur à l’École de gestion Rotman. Il a suffi de deux dons d’un million et de trois autres d’un quart de million. » Néanmoins, contrairement à l’École de commerce de Harvard, les cours d’histoire ne sont pas obligatoires au MBA de Rotman – on y accepte l’histoire, sans plus. Et les entreprises n’écrivent pas « Bienvenue aux diplômé.e.s en sciences humaines » en majuscules et en gras dans leurs offres d’emploi.
L’étude de l’histoire et l’expertise historique ont beaucoup à offrir tant aux personnes qu’aux entités économiques. Elles n’offrent toutefois pas l’attrait d’une formation préparatoire à l’emploi. Tant et aussi longtemps que nous vivrons dans une société commerciale, les sciences humaines devront prouver aux bailleurs de fonds et – pardonnez-moi l’usage du terme – aux client.e.s potentiel.le.s qu’elles peuvent procurer, outre une satisfaction intellectuelle, des avantages économiques. Elles devront commercialiser la valeur de l’histoire.
