Sortir de l’ombre du prestige universitaire
D’une université prestigieuse à une université ouverte et inclusive, le parcours d’un professeur de première génération qui interroge l’obsession du prestige, ses angles morts sociaux et ce qu’elle nous empêche de voir de l’excellence réelle.

Je suis récemment tombé sur une offre d’emploi d’une université prestigieuse. Pendant un instant, je me suis surpris à imaginer ce que ce serait de travailler dans un tel établissement, avant de me rappeler que j’ai déjà l’essentiel : un poste menant à la permanence, des étudiantes et étudiants engagés et des ressources pour mener mes recherches. Pourtant, le simple nom de cet établissement a réveillé une idée tenace : celle que je vaudrais davantage si je travaillais dans une université d’élite.
Selon Thomas Spiegler et Antje Bednarek, les étudiantes et étudiants de première génération « sont plus susceptibles d’étudier […] dans des universités moins prestigieuses ». Moi, j’ai fait le contraire. Je suis allé à McGill, en croyant que son prestige compenserait toutes mes lacunes : l’absence de réseau, la méconnaissance des codes tacites du milieu universitaire et le sentiment de ne pas vraiment y avoir ma place. Je voulais faire mes preuves dans un endroit dont la réputation finirait par déteindre un peu sur moi. Du moins c’est ce que j’espérais.
Impossible pourtant d’ignorer l’écart entre mon milieu d’origine et les cercles où j’évoluais désormais. Je me souviens d’un professeur qui voulait savoir quelle école secondaire privée j’avais fréquentée et qui ne citait que les plus exclusives de Montréal. Quand je lui ai donné le nom de mon école publique, il a marqué un temps d’arrêt. Le sous-entendu était évident : les étudiantes et étudiants comme moi se retrouvaient rarement ici, et lorsqu’ils y arrivaient, leur décalage sautait généralement aux yeux. Les données de Spiegler et Bednarekmontrent que « plus les étudiantes et étudiants appartiennent à des couches sociales favorisées, plus ils ont de chances de réussir dans les établissements d’enseignement », de sorte que ma réussite pouvait naturellement être interprétée comme le reflet d’un milieu social privilégié.
Comme l’expliquent Ryan D. Ward et coll., « le capital culturel englobe les connaissances que les étudiantes et étudiants et leurs familles possèdent sur les facteurs qui conditionnent l’accès à l’université […] ainsi que la capacité d’y poursuivre des études », qu’il s’agisse d’apprivoiser le processus d’admission, d’obtenir du mentorat ou de tirer parti des ressources disponibles. Bien que mon expérience en tant qu’étudiant de première génération à McGill m’ait forcé à apprendre tout cela, mon approche, qui consistait à « faire semblant » jusqu’à ce que j’y arrive, était souvent épuisante, et je continuais à me sentir comme un intrus.
Lorsque le moment est venu de postuler aux programmes de doctorat, la hiérarchie du prestige s’est imposée plus nettement encore. En théorie, l’Université du Québec à Montréal était le choix idéal : le meilleur directeur de recherche pour mon projet y travaillait, et le département était dynamique et innovant. Mais dire que je quittais les couloirs chargés d’histoire de McGill pour ceux, plus récents et moins renommés, de l’UQAM, me donnait parfois l’impression d’avouer un d’échec, comme si les gens allaient croire que je n’avais pas été à la hauteur. En réalité, j’y ai trouvé un environnement où une population étudiante très diversifiée partageait des espaces physiques, intellectuels et idéologiques. J’y ai découvert le plaisir d’enseigner à des personnes qui n’étaient pas destinées, par leur naissance, leur classe sociale ou leur milieu familial, à fréquenter l’université, mais qui y étaient arrivées malgré les obstacles.
Lorsque j’ai commencé à postuler à des emplois, j’ai vu comment le prestige agissait comme un filtre invisible. Après toutes ces années à me dépasser pour prouver ma valeur comme chercheur, j’ai seulement décroché des entretiens avec des universités publiques (il n’y avait pas d’offres dans mon domaine au Canada lorsque j’ai terminé mon doctorat, je me suis donc tourné vers le marché américain), tandis que les établissements privés d’élite n’ont visiblement accordé aucune attention à ma candidature. Dans un article publié en 2019 dans la Revue canadienne de sociologie, Andrew Nevin explique que « si le prestige de l’établissement ou du département est considéré comme un indicateur de compétence dès le début du processus [d’embauche], il est plus probable que les candidates et candidats qualifiés issus de milieux moins prestigieux soient ignorés, ce qui perpétue la fermeture sociale du réseau ». Par conséquent, les titulaires d’un doctorat provenant d’universités moins connues ont rarement accès à des postes dans des établissements d’élite – voire à un poste tout court.
Aujourd’hui, en tant que professeur adjoint, je travaille dans une université ouverte qui existe en grande partie en marge de l’économie du prestige. J’enseigne à des étudiantes et étudiants de première génération, à des parents, à des apprenantes et apprenants autochtones, à des personnes vivant dans des régions éloignées et à des personnes plus âgées. Même si leurs visages n’apparaissent généralement pas dans les brochures promotionnelles, ce sont celles et ceux pour qui l’enseignement supérieur peut être le plus transformateur. Parce que nous avons été conditionnés à associer prestige et excellence, l’idée même de qualifier mon université de non prestigieuse ressemble à une trahison. Mais travailler dans un établissement non traditionnel m’a révélé la force discrète des milieux universitaires inclusifs et moins prestigieux : cette force souvent négligée, mais profondément transformatrice qui naît dans des environnements où l’accessibilité, l’expérimentation et le souci des personnes priment sur la réputation.
Rien de tout cela ne signifie que l’excellence et la rigueur n’ont pas d’importance. Mais si l’on regarde le prestige sous l’angle de l’inclusivité, on commence à reconnaître la valeur des établissements qui élargissent le champ des possibles au lieu de le réduire. Si j’ai pu étudier à McGill, c’est aussi parce que je bénéficiais de différentes formes de privilège (homme blanc bilingue vivant dans la région de Montréal). D’autres étudiantes et étudiants de première génération n’ont pas cette chance et ont besoin d’espaces conçus pour leur permettre de s’épanouir et d’apprendre. Étant donné que « les étudiantes et étudiants de première génération peuvent également reproduire le mécanisme oppressif » qui sous-tend le prestige universitaire, il d’autant plus important pour les professeures et professeurs de première génération de les encadrer et de les encourager.
Même maintenant que j’ai « réussi » selon les critères traditionnels, je lutte encore avec la place que le prestige occupe dans ma perception de ma valeur universitaire. Alors que les discussions sur l’équité et l’accès continuent de remodeler l’enseignement supérieur, nous devons démêler cet enchevêtrement et engager enfin une réflexion collective sur la façon de désapprendre l’élitisme universitaire. Pour ce faire, nous devrons toutes et tous nous pencher sur les valeurs et les idées préconçues que le monde universitaire perpétue, des processus d’admission aux comités d’embauche.
Si les universités veulent vraiment incarner l’équité, elles doivent élargir les formes de mérite qu’elles récompensent : la recherche en milieu communautaire, l’enseignement qui touche les étudiantes et étudiants marginalisés et les savoirs produits en dehors des centres de pouvoir traditionnels. L’ombre du prestige continuera sans doute de planer sur le monde universitaire, mais nous pouvons au moins remarquer lorsqu’il nous aveugle au point de ne plus voir le travail transformateur qui s’accomplit en marge. Et peut-être que si nous écoutons plus attentivement les histoires de celles et ceux qui s’épanouissent loin de cette ombre, nous pourrons redéfinir ce que valoir plus signifie réellement.
Postes vedettes
- Sociologie - Professeure adjointe ou professeur adjoint (féminismes, genres et sexualités dans les mondes noirs, africains et caribéens)Université de Montréal
- Aménagement - Professeure adjointe / agrégée ou professeur adjoint / agrégé (design d’intérieur)Université de Montréal
- Architecture - Professeure adjointe ou professeur adjoint (humanités environnementales et design)Université McGill
- Sciences de la terre et de l'environnement - Professeure adjointe ou professeur adjoint (hydrogéologie ou hydrologie)Université d'Ottawa
- Études culturelles - Professeure ou professeurInstitut national de la recherche scientifique (INRS)



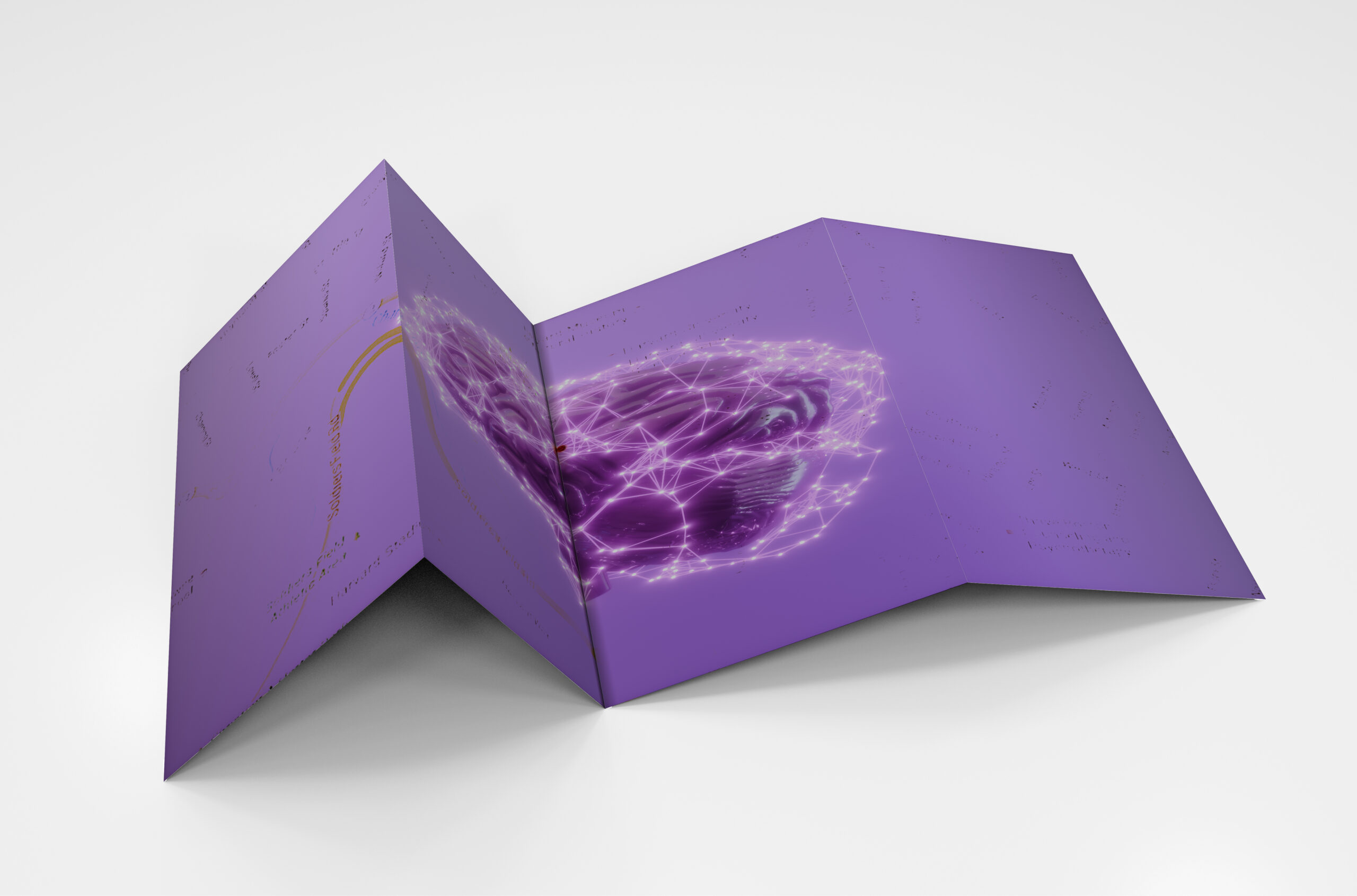







Laisser un commentaire
Affaires universitaires fait la modération de tous les commentaires en appliquant les principes suivants. Lorsqu’ils sont approuvés, les commentaires sont généralement publiés dans un délai d’un jour ouvrable. Les commentaires particulièrement instructifs pourraient être publiés également dans une édition papier ou ailleurs.