Pour se rendre à l’Institut d’urbanisme Ryerson, il faut d’abord entrer au 10, rue Dundas Est, à quelques pas de la bruyante rue Yonge et de ses gigantesques panneaux publicitaires, de même que du square Dundas, à l’activité très souvent chaotique. On tourne ensuite à droite au bourdonnant Starbucks du rez-de-chaussée avant d’emprunter un minuscule ascenseur pour atteindre le 10e étage.
Les modestes bureaux de l’Institut, qui compte quatre employés, se trouvent quelques étages au-dessus de DMZ, l’incubateur d’entreprises en perpétuelle expansion de l’Université Ryerson, et du complexe cinématographique Cineplex Odeon, dont les locaux se transforment en salles de conférence les matins de semaine. La directrice générale de l’Institut, Cherise Burda, parle d’une « utilisation très judicieuse de l’espace ».
Les membres de l’Institut rédigent, seuls ou avec divers partenaires (dont des professeurs de l’Université Ryerson), des documents stratégiques sur des questions comme le coût du logement, le contrôle des loyers ou les transports publics. L’Institut aide aussi à l’organisation d’activités comme Yonge Love, qui permet à des urbanistes, des décideurs ainsi que des représentants d’autres villes et de l’Université Ryerson de discuter des plans de développement de la rue Yonge.
Même si l’Institut ne construit rien au sens physique, ses projets et son emplacement dans cette zone dense du centre-ville sont à l’image des choix de l’Université Ryerson en matière d’infrastructure. L’établissement a déplacé son école de gestion Ted Rogers au Centre Eaton, transformé en centre récréatif le Maple Leaf Gardens (dont la patinoire est désormais fréquemment accessible au public) et récemment érigé un centre étudiant sur l’ancien site du célèbre magasin Sam the Record Man.
Son emplacement et sa philosophie font de l’Université Ryerson un chef de file canadien de cette démarche en plusieurs volets déployée par les universités pour diriger le développement urbain. « Il ne s’agit pas seulement de bâtir une ville en la dotant d’infrastructures physiques, précise Mme Burda. Il s’agit également d’avoir un impact sur les programmes sociaux, les services et les politiques. C’est aussi une question d’investissement, de réflexion, d’imagination et de vision de la croissance urbaine. »
Les universités ont toujours bâti des immeubles. Elles se sont tou-jours penchées sur les problèmes d’urbanisme, d’architecture, de logement, de transport ou de services sociaux, et elles ont toujours tenté de les résoudre en se fondant sur des données probantes. Mais le mouvement bâtir une ville, qui prend de l’ampleur au Canada comme dans les autres pays développés, repose sur une démarche proactive. Les universités souhaitent de plus en plus influencer la stratégie de développement des villes, par divers moyens : espaces partagés, partenariats, colloques publics, projets communautaires, débats médiatiques, etc.
« Nous tentons de tisser un lien avec la ville au coeur de laquelle nous sommes et d’exprimer ce que nous souhaitons qu’elle devienne », affirme Shauna Brail, conseillère en stratégie urbaine auprès du recteur de l’Université de Toronto.
En transformant les villes qui les abritent, les universités se transforment elles-mêmes. « Il n’y a pas la ville d’un côté, et l’université de l’autre », explique Janet Moore, professeure agrégée au Centre de dialogue de l’Université Simon Fraser et cofondatrice de CityStudio Vancouver, un projet qui amène étudiants, membres de la collectivité et personnel municipal à travailler ensemble et que Mme Moore qualifie de « structure d’apprentissage hybride ».
En réalité, plus les projets se complexifient et plus les universités s’étendent avec créativité dans les zones environnantes, plus les frontières s’estompent. Personne ne sait plus où commence et où finit un campus. « L’université est désormais intégrée à la ville, résume Mme Burda, elle n’est plus une forteresse. »
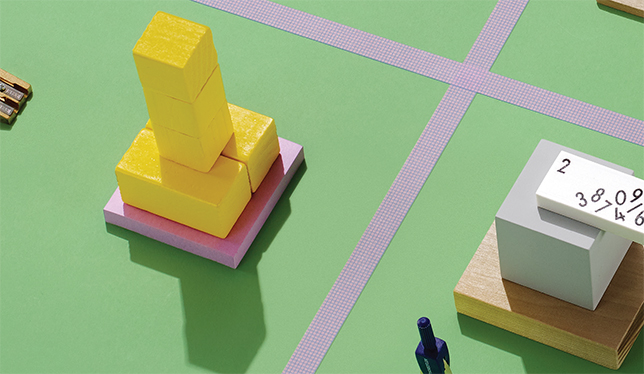
Les universités ont d’abord été de prestigieux sanctuaires du savoir, retranchés dans de majestueux immeubles entourés de pelouses verdoyantes et de portails en pierre. Puis, vers 1950, l’émergence du concept d’université publique a fait prendre conscience de la contribution des établissements d’enseignement postsecondaire au développement socioéconomique régional. Le Canada a donc favorisé la création de collèges et d’universités, principalement en banlieue. « Les campus situés hors des villes sont devenus la norme », explique le recteur de l’Université Simon Fraser, Andrew Petter.
Fait ironique : nombre de ces nouveaux campus sont cernés de barrières, bien qu’ils se dressent sur des terres agricoles peu chères, loin des zones d’hébergement ou des systèmes de transport. Si certaines universités ont dès le départ tissé des liens avec la collectivité (comme l’Université Simon Fraser, dont le campus de Burnaby a été bâti avec la participation de la collectivité et dont le campus de Vancouver est intégré au tissu urbain), la plupart n’ont guère ressenti le besoin d’interagir avec elle.
L’Université York, par exemple, « entretenait jadis de très mauvaises relations avec la collectivité », se souvient Roger Keil, titulaire de la chaire d’études urbaines et des banlieues de cet établissement où il a déjà passé 25 ans. La vallée de Black Creek « constituait un obstacle qui tenait les jeunes à distance », raconte-t-il. À la même époque, les établissements situés au centre-ville, comme l’Université Ryerson, portaient peu d’attention aux populations à faible revenu, participant très peu au développement des entreprises et du commerce de détail.
Pendant ce temps, la population urbaine du pays a continué de croître (selon Statistique Canada, en 2011, 81 pour cent des Canadiens vivaient en zone urbaine). Avec la multiplication des projets de recherche communautaire, des partenariats gouvernement-secteur privé et des programmes coopératifs, un nombre croissant d’universités en sont venues à mieux comprendre leur voisinage et à interagir davantage avec lui. Les bâtisseurs d’universités ont commencé à discuter avec les populations locales (pour obtenir des terrains dans le cas de celles qui sont situées en zones urbaines, ou pour bénéficier de services de transport et d’hébergement dans le cas de celles qui sont situées en banlieue). Peu à peu, les collectivités ont fait appel aux conseils des universités.
Puis, la notion de bâtir une ville (« city building » en anglais) a émergé. En 2011, Sheldon Levy, alors recteur de l’Université Ryerson, déclarait lors d’une conférence TEDx : « En bâtissant l’université, nous bâtissons la ville ». À la même époque, Lloyd Axworthy déclarait au Winnipeg Free Press que le campus de l’Université de Winnipeg, dont il était alors recteur, était « au coeur de la définition de Winnipeg, ne constituait pas un îlot au sein de la collectivité, mais plutôt une partie de celle-ci ». (M. Axworthy a été directeur de l’Institut d’urbanisme de l’Université de Winnipeg au début des années 1970, avant d’entrer en politique.) Toujours en 2011, Mme Moore et Duane Elverum (alors professeur à l’Institut Emily Carr d’art et de design et qui enseigne aujourd’hui à l’Université Simon Fraser) ont fondé CityStudio.
Dès 2014, le concept de bâtir une ville a semblé gagner en popularité au Canada. « Les universités sont appelées à jouer un rôle croissant au sein de leur collectivité dans tous les aspects de l’évolution des villes », affirmait ce printemps devant le conseil municipal de Montréal Suzanne Fortier, principale de l’Université McGill. Un mois plus tard, le recteur de l’Université de Toronto, Meric Gertler, théoricien de l’urbanisme reconnu, déclarait lors d’une conférence devant la chambre de commerce de la région de Toronto : « En termes simples, une université forte contribue à bâtir une ville forte. » (Quand il est devenu recteur de l’Université de Toronto, en 2013, M. Gertler a affirmé que l’une de ses trois priorités serait de « mieux tirer parti des emplacements urbains de l’établissement, pour le bien de celui-ci et de la ville ».) En 2015, l’Université Simon Fraser a tenu un sommet communautaire d’une semaine sur comment bâtir une ville.
Aujourd’hui, le mouvement bâtir une ville est bien vivant dans les universités, partout au pays, et dans les villes petites et grandes. En janvier dernier, le conseil municipal de Kingston, en Ontario, a voté en faveur d’un accord prévoyant que l’Université Queen’s et la municipalité travailleront ensemble à soutenir l’innovation et le développement économique, ainsi qu’à retenir davantage de jeunes au sein de la collectivité. En février, l’Université de Calgary a lancé l’initiative Innovation civique YYC, qui permet à l’établissement, à la collectivité et au gouvernement de travailler ensemble à des idées et à des projets axés sur la ville.
En juin, la Ville de Montréal a signé avec 10 universités et collèges présents sur son territoire un accord quinquennal pour souligner leur contribution à son développement socioéconomique. L’accord vise notamment à créer un bureau de l’enseignement supérieur faisant office de « lien permanent » entre la municipalité et ses établissements postsecondaires. L’accord prévoit que la Ville « stimule et soutienne l’écosystème de l’innovation montréalais, afin de mieux utiliser la propriété intellectuelle… et à mieux commercialiser les résultats de recherche ». En contrepartie, les universités s’engagent notamment à « encourager et favoriser la collaboration entre les professeurs, chercheurs et groupes de recherche afin de documenter, étudier et résoudre diverses problématiques soumises par les services de la Ville de Montréal ».

Les projets peuvent prendre diverses formes, souvent modestes au départ. En menant des recherches communautaires dans les quartiers à faible revenu et à majorité autochtone au nord de Winnipeg, Jim Silver, qui dirige le département d’études urbaines et des centres-villes de l’Université de Winnipeg et y enseigne, s’est dit que l’implantation d’un bureau et de classes dans cette zone pourrait aider à recruter des étudiants. Ses supérieurs ayant rejeté son idée, M. Silver l’a soumise à M. Axworthy, qui en a été enchanté.
« Ça a merveilleusement fonctionné, déclare M. Silver à propos de cette vitrine créée dès 2010. Ça a contribué à rendre l’éducation post-
secondaire accessible. » Des jeunes du quartier se sont inscrits à des programmes menant à l’obtention de diplôme. Des étudiants au premier cycle du campus principal sont venus sur l’avenue Selkirk. « Certains n’avaient jamais mis les pieds dans le nord de la ville. Ça les a transformés », affirme M. Silver.
M. Silver était toutefois conscient que l’existence de certains lieux entravait le changement. Tel était entre autres le cas du Merchant’s Hotel, « véritable aimant à problèmes typiques des centres-villes » selon lui. En 2011, en collaboration avec la collectivité et le gouvernement, M. Silver et son équipe ont obtenu la fermeture de cet hôtel datant de 1913. Après l’avoir racheté (avec plusieurs terrains adjacents), puis démoli, ils ont recueilli 15 millions de dollars provenant surtout du gouvernement pour bâtir un nouvel immeuble destiné à abriter le département.
Une fois achevé, en janvier 2018, ce complexe proposera des cours universitaires, des programmes parascolaires pour les jeunes et des programmes en oji-cri pour les adultes, en plus d’abriter un café exploité dans le cadre d’un programme d’études secondaires en art culinaire, ainsi que 30 logements étudiants subventionnés à prix abordable. L’Université de Winnipeg, qui gère aussi d’autres programmes axés sur la collectivité, a récemment bâti un complexe récréatif qu’elle partage avec celle-ci.
Plus à l’ouest, en 2010, le maire de Vancouver a déclaré son intention de faire de sa ville la plus écologique de la planète d’ici 2020 et s’est dit en quête de propositions. Mme Moore et M. Elverum ont alors eu l’idée de créer un partenariat avec la municipalité pour permettre aux étudiants d’effectuer de petits travaux dans le cadre de projets communautaires – « on parle d’acupuncture urbaine », précise Mme Moore, ajoutant à titre d’exemple que « le fait de peindre les rues change la manière de voir la ville ». Dès que la municipalité a eu vent du concept du duo sur les réseaux sociaux, celui-ci s’est vu offrir un bureau à l’Hôtel de Ville.
CityStudio Vancouver consiste aujourd’hui en un partenariat de six établissements postsecondaires, qui dépêchent des étudiants à l’hôtel de ville pour mettre des projets sur pied et obtenir ainsi des crédits. Les étudiants participants ont « accompli des choses qui ne l’auraient pas été sans eux », comme recréer des comptoirs de réparation de vélos, installer des pianos d’occasion dans les parcs en été, ou encore mettre sur pied un programme d’installation de poubelles rouges destinées aux déjections canines dans un parc. Nombre de projets de CityStudio ont pris de l’ampleur et perduré (il y a maintenant des poubelles rouges dans toute la ville).
CityStudio ayant partagé son concept, cinq villes ont décidé de créer leur propre branche : Victoria, en collaboration avec l’Université de Victoria, l’Université Royal Roads et le Collège Camosun; Corner Brook, à Terre-Neuve, en partenariat avec le campus Grenfell de l’Université Memorial; Waterloo et Brantford, en Ontario, en collaboration avec l’Université Wilfrid Laurier; et Hamilton, en Ontario, dont la branche appelée CityLAB a été créée en collaboration avec l’Université McMaster, l’Université Redeemer et le Collège Mohawk.
Les projets bâtir une ville semblent adaptés à une foule de structures administratives. À Toronto, les recteurs des quatre universités de la région, qui se réunissent fréquemment, ont décidé en 2015 de financer une étude sur le transport des étudiants, StudentMoveTO, dont les résultats préliminaires ont été publiés en 2016. Ces mêmes recteurs ont depuis commandé un autre rapport portant sur l’hébergement à prix abordable. (Ils ont également collaboré au projet Lifeline Syria, qui a déjà financé l’accueil de plus de 1 000 réfugiés syriens.)
Il existe au Canada d’innombrables petits projets du même genre. Par exemple, un projet mis sur pied par deux groupes d’étudiants en architecture de l’Université Carleton et financé par des groupes d’entreprises locales, visant à transformer 25 stationnements en parcs avec bancs, fleurs et dispositifs de collecte des eaux de pluie. Un premier stationnement a été transformé en parc en 2016.

« Les universités qui s’emploient à dynamiser leur région le font aussi dans leur propre intérêt, précise M. Gertler de l’Université de Toronto. La qualité de vie est notre atout premier, un de ceux qui nous aident à attirer et à retenir le personnel et les étudiants. » De tels projets permettent aussi aux étudiants d’étoffer leur CV. « Mentionner sa participation peut faire bonne impression en entrevue et aider à obtenir un emploi », précise Mme Moore.
Les villes, les collectivités et les entreprises appuient les projets pour bâtir une ville. La première fois où M. Gertler en a parlé après avoir intégré l’Université de Toronto, il s’attendait à un tollé. « J’ai été agréablement surpris de voir que les gens adhéraient au concept, il y a eu très peu de réactions négatives », raconte-t-il.
Apparemment, seuls les professeurs les plus traditionalistes sont réticents. « S’enfermer dans sa tour d’ivoire pour se couper encore plus de la collectivité ne peut qu’entraver la mission des universités », reconnaît M. Petter de l’Université Simon Fraser.
Il n’en reste pas moins que des défis persistent. Peu importe le projet universitaire, s’il n’est géré que par un professeur, il risque de tomber à l’eau si ce professeur s’en va ou est privé de financement. La lenteur des municipalités et des partenaires communautaires peut par ailleurs
poser problème aux étudiants aux prises avec des échéanciers. Mme Brail, de l’Université de Toronto, a récemment discuté avec un étudiant au doctorat qui craignait que sa participation à un groupe communautaire l’empêche de soumettre sa thèse à temps. « Sa thèse était sa priorité », confie-t-elle.
On peut aussi craindre que le débat croissant au sujet des villes fasse oublier les banlieues, qui enregistrent pourtant la plus forte croissance démographique au pays. Les problèmes liés aux transports, à la pauvreté ou à la diversité, par exemple, peuvent être bien plus complexes et difficiles à gérer s’ils concernent la banlieue.
Les stratégies et projets peuvent aussi se heurter à la bureaucratie et aux priorités conflictuelles des parties prenantes. M. Keil de l’Université York a été membre d’un groupe de planification régionale pendant des années. Il avoue avoir du mal à savoir si ce groupe a eu une influence directe. Il confie avoir parfois l’impression de « devoir hurler pour être écouté ».
Quoi qu’il en soit, l’appétit pour les petits et gros projets bâtir une ville va croissant. L’Institut d’urbanisme de l’Université Ryerson reçoit fréquemment des propositions, mais ne peut les accepter toutes. « Nos capacités ne sont pas suffisantes », déplore Mme Burda.
Selon M. Gertler, les frontières entre université et municipalité vont s’estomper du fait des besoins des collectivités, du désir des professeurs de voir émerger une planification fondée sur des données probantes et du souhait des étudiants de bénéficier d’un apprentissage par l’expérience. « On commence à peine à entrevoir les puissantes répercussions de cette évolution sur les universités, affirme M. Gertler. Cet élan nous pousse à nous tourner vers l’extérieur, à ouvrir les bras à nos voisins et au monde. »
