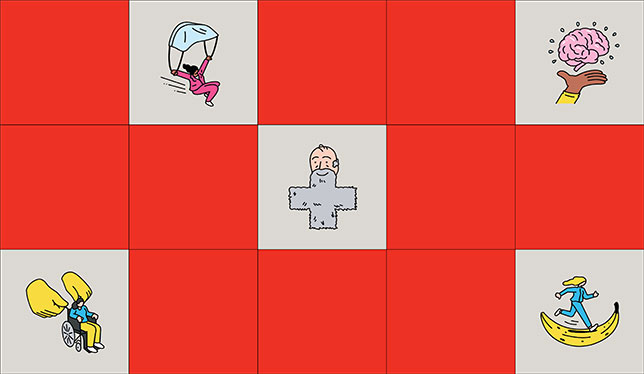Comme la plupart des organismes de prestation de soins de santé, Lakeridge Health, à l’est de Toronto, a dû de toute urgence redéployer son personnel et recruter de nouveaux employés lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé. Mais les restrictions liées à la crise sanitaire l’empêchaient d’organiser en personne sa formation d’accueil obligatoire sur la prévention des accidents du travail.
C’est à ce moment-là que le travail préparatoire effectué des mois plus tôt par l’Université Ontario Tech, située à proximité, a commencé à porter ses fruits. Cette université d’Oshawa, en Ontario, avait sollicité l’avis de Lakeridge Health sur un programme sur la sécurité des déplacements de patients, initialement destiné aux étudiants en soins infirmiers de l’Université, mais avec l’objectif de profiter à une vaste gamme de professionnels de la santé. Conçu comme une « microcertification », ce programme pouvait être suivi en moins de 12 heures et permettait d’acquérir un ensemble déterminé de compétences recherchées par les employeurs. Il était soutenu par un financement pilote accordé par le gouvernement de l’Ontario pour le développement de microcertifications en 2019.
Bien que le lancement de la microcertification ait été reporté en raison de la pandémie, l’Université Ontario Tech a envoyé la partie en ligne du contenu du programme à Lakeridge Health, à sa demande, afin qu’elle puisse servir de formation provisoire pour ses nouveaux employés, dont certains étaient des diplômés récents de l’établissement d’enseignement.
« C’était une toute petite chose que nous pouvions faire dans ces premiers temps, explique Fiona McArthur, gestionnaire de projets stratégiques à l’Université Ontario Tech. [Lakeridge Health] avait cocréé le matériel avec nous. » L’Université offre un éventail de microcertifications; certaines portent sur des compétences non techniques, comme l’écoute active, et sont financées par le Groupe Banque TD; d’autres sont axées sur des compétences technologiques, comme l’analyse commerciale, par l’intermédiaire d’une filiale de l’Université.
« Si nous n’avions pas eu ce programme, nous aurions eu beaucoup de mal à trouver quelque chose pour le remplacer, déclare Philip Salim, membre de l’équipe de santé et de sécurité au travail de Lakeridge Health. Il traite de tout ce qui doit être abordé dans notre programme de formation. »
Depuis quatre ans, le terme « microcertification » est sur les lèvres d’un nombre croissant d’administrateurs et de professeurs du milieu de l’enseignement postsecondaire canadien, ce qui reflète la tendance à l’échelle mondiale. La pandémie a ensuite servi de catalyseur, et des microcertifications figurent maintenant dans les plans de relance des gouvernements soucieux de faire face aux pertes massives d’emplois et d’aider les employeurs frustrés se plaignant de pénurie de main-d’oeuvre et de difficultés à trouver des gens ayant certaines compétences précises. Si les définitions varient, tout comme les noms (badges numériques, microcours, nanoprogrammes, etc.), l’idée de base est qu’il s’agit de cours de courte durée qui permettent de développer et de valider une aptitude, une connaissance ou une compétence particulière recherchée par les employeurs, et d’aider les apprenants à combler l’écart entre leurs compétences et leurs connaissances préexistantes afin de répondre à l’évolution rapide de la demande du marché du travail sans qu’ils n’aient besoin d’arrêter de travailler. Les microcertifications sont conçues pour être pratiques. Elles sont souvent offertes en ligne, et généralement par l’intermédiaire des services de formation continue. Certaines sont si bien intégrées au mode virtuel que leur détenteur peut les inclure à un curriculum vitae électronique affiché sur les réseaux sociaux, comme LinkedIn, ce qui permet aux employeurs potentiels de cliquer sur la certification et de vérifier immédiatement son authenticité et les compétences qu’elle confère.
« Nous considérons que les microcertifications donnent accès à des programmes axés sur les compétences, dirigés par des experts en la matière, qui permettent aux étudiants d’affiner leurs aptitudes dans leur domaine et leur discipline, et d’acquérir davantage de confiance et de préparation pour poursuivre leurs objectifs de carrière », explique Alishau Diebold, présidente de l’Association des étudiants des cycles supérieurs de l’Université Wilfrid Laurier, qui a été consultée par l’administration de l’Université sur la mise en oeuvre des microcertifications.
Un peu d’histoire
L’origine des microcertifications remonte au mouvement voulant démocratiser et révolutionner l’enseignement postsecondaire traditionnel par le biais d’offres numériques telles que les cours en ligne ouverts et massifs (CLOM) et les plateformes d’enseignement en ligne, comme Coursera. La Nouvelle-Zélande a été la première à intégrer des microcertifications dans son système d’éducation en 2017, lorsque son autorité compétente en matière de formation a collaboré avec Otago Polytechnic, qui proposait des « fragments de formation (edubits) », et Udacity, une société américaine d’enseignement en ligne qui propose des « nanodiplômes (nanodegrees) ». Les microcertifications font désormais partie du système national de formation de la Nouvelle-Zélande, ce qui en fait une certification reconnue, assortie de critères fixes et soumise à une procédure d’approbation, comme les diplômes et les grades. Des cadres de reconnaissance des microcertifications sont également élaborés à l’échelle internationale par des groupes tels que l’Organisation de coopération et de développement économiques et la Commission européenne, dans le but de soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et les occasions flexibles pour les adultes de « se perfectionner et de se recycler ».
Cet intérêt planétaire s’est aussi manifesté par des investissements gouvernementaux importants au cours des deux dernières années :
59,5 millions de dollars annoncés par le gouvernement de l’Ontario à la fin de 2020 pour financer le développement de microcertifications et de prêts étudiants liés à celles-ci; 9 millions de dollars annoncés par le gouvernement de la Colombie-Britannique depuis 2020, avec le soutien du gouvernement fédéral; et 5,6 millions de dollars annoncés par le gouvernement de l’Alberta en août dernier pour des projets pilotes de microcertifications. Ce dernier investissement donnait suite à la publication par le Conseil albertain des affaires (BCA) en 2020 d’un rapport exhortant les gouvernements provincial et fédéral à élargir l’offre de microcertifications. L’organisation d’apprentissage numérique soutenue par le gouvernement de l’Ontario, eCampusOntario, travaille dans ce domaine depuis 2017.
Les microcertifications dans les universités canadiennes : exemples et nouveautés
- Le campus de Calgary de l’Université de Lethbridge, axé sur les apprenants adultes, élabore une microcertification qui aiderait les personnes dont l’emploi est précaire ou déjà éliminé, par exemple dans l’industrie pétrolière, à transposer leurs compétences pour s’orienter vers des emplois dans l’industrie cinématographique, qui prend de l’ampleur en Alberta. L’Université a collaboré avec Développement économique Calgary et la section locale albertaine de la Guilde canadienne des réalisateurs dans l’espoir d’obtenir la participation d’un important syndicat pour valider le programme. Grâce à un financement du gouvernement del’Alberta, l’objectif est d’étendre le programme au-delà des microcertifications initiales et d’en faire une série qui pourrait être combinée en un certificat non crédité. L’Université de Lethbridge offre également des microcertifications pouvant être cumulées avec plusieurs certifications de niveau supérieur liées aux sciences et à la gestion des services de santé.
- Depuis décembre 2019, l’Université Laval offre 13 « nanoprogrammes » et quatre autres sont en cours d’élaboration. Ils abordent des thèmes tels que la pharmacologie et la santé des aînés, l’enseignement de compétences sociales et émotionnelles aux élèves du primaire, ainsi que la protection des milieux humides. Tous les nanoprogrammes sont élaborés en collaboration avec des partenaires externes et visent à développer des compétences professionnelles prisées. Ils peuvent également faire le pont vers des programmes d’études réguliers. Près de 500 apprenants se sont inscrits à ces nanoprogrammes, dont la durée varie de 90 à 135 heures sur environ six mois.
- L’Université de Regina propose plusieurs microcertifications sur des sujets liés aux affaires, obtenus en accumulant des badges numériques. L’été dernier, elle a été la première université canadienne à émettre une certification en matière de microcertifications par le biais de la plateforme MyCreds, un espace de stockage numérique pour les titres de compétences postsecondaires établi par l’Association des registraires des universités et collèges du Canada.
- L’année dernière, l’Université du Manitoba a intégré les microcertifications dans ses certificats et diplômes, créant ainsi des possibilités pour l’élaboration de microcertifications non diplômants et de microdiplômes de premier cycle (de 9 à 18 heures de crédit) pouvant être utilisés pour l’obtention de diplômes ou être reconnus dans le cadre de programmes de premier cycle.
- En 2020, l’Université Thompson Rivers est devenue la première université nord-américaine à accepter le transfert international de microcertifications d’apprentissage ouvert, obtenus par le biais du réseau Open Education Resource universitas, dont les cours sont gratuits tandis que les évaluations et la certification sont payantes. Les crédits peuvent être cumulés en vue d’une certification de niveau universitaire.
- Aussi, eCampusOntario a lancé 36 programmes pilotes de microcertifications, dont la moitié dans des universités ontariennes. Parmi les exemples, mentionnons la gestion du changement dans le secteur sans but lucratif, un partenariat entre l’Université Western et deux organismes sans but lucratif locaux, et la conception de microcertifications en mathématiques, offertes par l’Université Lakehead afin de soutenir le perfectionnement des travailleurs ou d’éventuels étudiants universitaires dans les communautés du Nord ou autochtones.
La mise en oeuvre de microcertifications figure dans les plans stratégiques de l’Université du Nouveau-Brunswick et de l’Université Dalhousie. Dès 2015, l’Université de la Colombie-Britannique a encouragé l’utilisation de « badges ouverts » pour reconnaître les compétences distinctes que les étudiants avaient acquises dans le cadre de cours crédités. Elle a commencé à offrir plusieurs microcertifications non créditées en 2021, grâce à un financement provincial.
« Il y a beaucoup de potentiel pour différentes clientèles », affirme Dany Benoit, directeur de la formation continue à l’Université de Moncton. Il a déjà l’intention de créer une « longue liste » de microprogrammes d’ici l’année prochaine, certains résultant du changement de nom et de la mise à jour de cours existants et d’autres tirés des facultés de l’Université, comme la combinaison des domaines en informatique et en santé dans un microprogramme sur la prestation numérique de soins de santé. « C’est un moyen de répondre aux besoins [des apprenants], mais aussi de les intéresser à peut-être suivre d’autres programmes à l’Université, explique M. Benoit. Si vous avez un microprogramme de niveau supérieur dans un domaine de l’administration des affaires et que l’apprenant l’aime et veut poursuivre, peut-être qu’il s’inscrira à une maîtrise en administration des affaires. »
« Nous considérons que les microcertifications donnent accès à des programmes axés sur les compétences, dirigés par des experts en la matière, qui permettent aux étudiants d’affiner leurs aptitudes dans leur domaine et leur discipline. »
Outre le fait de créer d’une nouvelle source de revenus, les microcertifications sont considérées comme un moyen pour les universités de renouer avec les diplômés qui souhaitent actualiser leur curriculum vitae au cours de leur carrière et ainsi mieux répondre aux besoins des employeurs. C’est aussi une façon de satisfaire les besoins des apprenants qui sont de plus en plus à la recherche d’occasions d’apprentissage flexibles et pratiques, dont on trouve de nombreux exemples offerts à bas prix ou gratuitement en ligne, en présentant un titre de compétence reconnu comme une autre possibilité.
Pour les entreprises, les microcertifications ont été présentées comme une solution rapide pour surmonter la critique selon laquelle il manquerait des compétences essentielles aux nouveaux diplômés et que les universités sont réticentes au changement. Mike Holden, vice-président de la politique et économiste en chef au BCA, prend l’exemple d’un étudiant qui soumet un travail ou un rapport qui est évalué une fois, puis oublié. « Dans le monde réel, ce document fait l’objet d’un million d’allers-retours. C’est un processus itératif », explique-t-il.
Aider les étudiants à réussir sur le marché du travail
Outre les professionnels, les microcertifications s’adressent également aux étudiants de premier cycle. À l’Université Simon Fraser, les étudiants peuvent obtenir des microcertifications en suivant des cours optionnels crédités portant sur des compétences professionnelles recherchées, comme des compétences interculturelles et l’interprétation de données, dans le cadre de son programme FASS Forward. Certaines universités explorent l’utilisation de microcertifications pour valider des compétences particulières que les étudiants peuvent acquérir dans le cadre de cours réguliers donnant droit à des crédits, de programmes d’apprentissage intégré au travail ou même d’activités parascolaires.
« Nous considérons les microcertifications comme un outil très puissant pour faciliter l’entrée des titulaires de diplômes de deuxième ou troisième cycle sur le marché du travail », déclare Dianne Tyers, doyenne de l’apprentissage ouvert et du développement de carrière à l’Université Dalhousie. Son établissement propose au moins deux douzaines de microcertifications au moyen de l’apprentissage à distance, sur des sujets allant de la programmation informatique à l’opération sécuritaire d’un tracteur. D’ailleurs, l’Université envisage la possibilité d’établir des partenariats avec des entreprises sectorielles qui proposent elles-mêmes des cours menant à une microcertification.
L’établissement, en collaboration avec les professeurs, se penche sur la manière d’intégrer ou d’identifier les microcertifications potentielles dans les cours de premier cycle. « Si j’investis des dizaines de milliers de dollars et des années de ma vie dans un diplôme universitaire, dit Mme Tyers, je devrais être en mesure d’en retirer une certaine valeur sur le marché du travail. »
Les questions sur ce qui définit une microcertification et sur les personnes à qui ce format convient le mieux continuent d’être débattues et représentent le plus grand obstacle à l’avancée des travaux en la matière. Une microcertification devrait-elle être validée par l’industrie ou non? Doit-elle durer six heures, six semaines ou plus de six mois? Pour des cours crédités ou non crédités? Sous forme numérique? Et qui l’approuve? Au printemps dernier, eCampusOntario a publié un cadre pour l’élaboration de microcertifications, y compris un langage commun pour décrire les aptitudes et les compétences et l’exigence que la microcertification soit validée par un partenaire sectoriel externe, dans la mesure du possible. Bien que la plupart des provinces ne disposent pas de tels cadres, Collèges et Instituts Canada en a proposé un à l’échelle nationale l’an dernier. La Saskatchewan en a un en cours d’élaboration, et la Nouvelle-Écosse a commencé à travailler sur le sien à la fin de 2020.
« On craint que le secteur des microcertifications ne devienne comme un Far West, où il y a des centaines de microcertifications, toutes différentes, où l’on se demande ce qu’elles signifient et quelle est leur réelle valeur, explique Mme Tyers. Nous ne voulons pas créer une jungle en Nouvelle-Écosse. »
Les promoteurs des microcertifications parlent souvent de l’importance de la portabilité et de leur capacité à s’emboîter, c’est-à-dire des certifications qui peuvent être acceptées par un autre établissement et éventuellement cumulées pour obtenir un titre plus important, des certificats jusqu’aux diplômes. Cet idéal soulève des questions épineuses sur les approbations et l’assurance qualité. Dans un rapport publié en mars 2021, la Confédération des associations de professeurs des universités de la Colombie-Britannique estime que si un nombre croissant de programmes d’éducation permanente étaient convertis en microcertifications « et qu’il y a un chevauchement avec des programmes donnant droit à des crédits, alors les études permanentes devront s’ajuster pour mieux s’aligner sur le modèle de gouvernance collective de l’établissement ».
Une autre préoccupation soulevée par le rapport est le « démantèlement » potentiel des programmes d’études donnant droit à des crédits si les éléments relatifs aux compétences de ces programmes étaient convertis en microcertifications, en particulier dans l’éventualité où ils seraient ensuite cumulés pour l’obtention de diplômes ou de grades, comme certains, dont le BCA, en font la promotion.
Cette idée « s’appuie sur la notion que le tout n’est qu’une addition de divers éléments plutôt qu’un résultat qui va au-delà de la somme de ses parties. Toute notion de progression [éducative], de cohérence, de séquençage, disparaît avec les microcertifications », explique Leesa Wheelahan, professeure à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto. Son collègue Gavin Moodie et elle ont critiqué les microcertifications en les qualifiant de « compétences à la carte pour des boulots à la pige » qui privatisent encore davantage l’éducation. Plutôt que de se plier aux besoins changeants d’un monde du travail en constante évolution, les sociétés devraient veiller à ce que chacun ait accès à des compétences fondamentales utiles sur le marché du travail, affirment-ils.
En outre, la critique selon laquelle les universités sont déconnectées des besoins des employeurs est fausse et ne tient pas compte du fait que les universités sont souvent à la pointe des nouvelles connaissances qui, des années plus tard, transforment les milieux de travail, affirme Susan McCahan, vice-provost aux programmes universitaires et aux innovations dans l’enseignement de premier cycle à l’Université de Toronto. L’Université considère que tous les cours qui n’entrent pas dans le cadre de programmes comme une mineure pourraient devenir une microcertification, après approbation du doyen, bien que sa Faculté d’éducation permanente offre des microcertifications explicitement définies. Selon Mme McCahan, les professeurs et le personnel de l’Université se tiennent au courant des compétences recherchées grâce à des contacts réguliers avec des intervenants des secteurs privé et public, et de nombreux départements universitaires ont des conseils consultatifs composés de membres de l’extérieur afin de maintenir la pertinence des programmes d’études. « Notre objectif est que nos diplômés réussissent très bien, dit-elle. Nous nous en sortons bien quand ils s’en sortent bien. »
Malgré tous les efforts et l’argent consacrés aux microcertifications, leur promesse initiale est tombée à plat pour certains. De nombreux programmes portant cette étiquette sont des programmes préexistants rebaptisés, les établissements faisant valoir qu’ils proposent depuis longtemps des cours succincts et axés sur le développement de carrière. Les concevoir à partir de zéro peut s’avérer onéreux, surtout lorsqu’un cours plus succinct devrait coûter moins cher. « Il s’agit d’un cycle de développement rapide et, la plupart du temps, les universités ne sont pas en mesure d’y répondre », explique Emma Gooch, responsable du programme des microcertifications à eCampusOntario.
Ken Steele, un stratège de l’enseignement supérieur qui s’est d’abord enthousiasmé pour les microcertifications lorsqu’il en a entendu parler il y a plusieurs années, indique que « l’engouement est en train de s’essouffler, tout comme ce fut le cas pour les CLOM il y a 10 ans. Alors que la vision des microcertifications était d’ouvrir l’accès à l’enseignement postsecondaire et de permettre aux étudiants d’accumuler des certifications pouvant être cumulées et devenant progressivement un diplôme, il y a très peu de preuves que cela se produit ».
Pour sa part, Mme Gooch reconnaît que la combinaison des microcertifications est « le rêve, l’objectif de beaucoup de gens, mais nous n’y sommes pas encore ».
Malgré les sceptiques, l’Université Ontario Tech va de l’avant avec la nouvelle édition de sa microcertification sur le déplacement des patients, abordant cette fois leur sécurité, d’après les leçons apprises dans les soins de longue durée lors de la pandémie et grâce à l’appui d’un autre investissement pour projet pilote de eCampusOntario. Compte tenu de la demande croissante pour des professionnels du milieu de la santé, le programme semble taillé sur mesure pour la période actuelle.
« Je travaille sur les microcertifications depuis trois ans », dit Mme McArthur de l’Université Ontario Tech. Pourtant, ce n’est que tout récemment que son dur labeur a été reconnu, grâce à des investissements gouvernementaux qui, selon elle, aident les professionnels de l’éducation à transformer la créativité qu’ils ont toujours eue en occasions d’apprentissage nouvelles et passionnantes. « Je suis passée du stade où je me parlais à moi-même dans un coin à celui où je suis la personne la plus populaire du campus. »